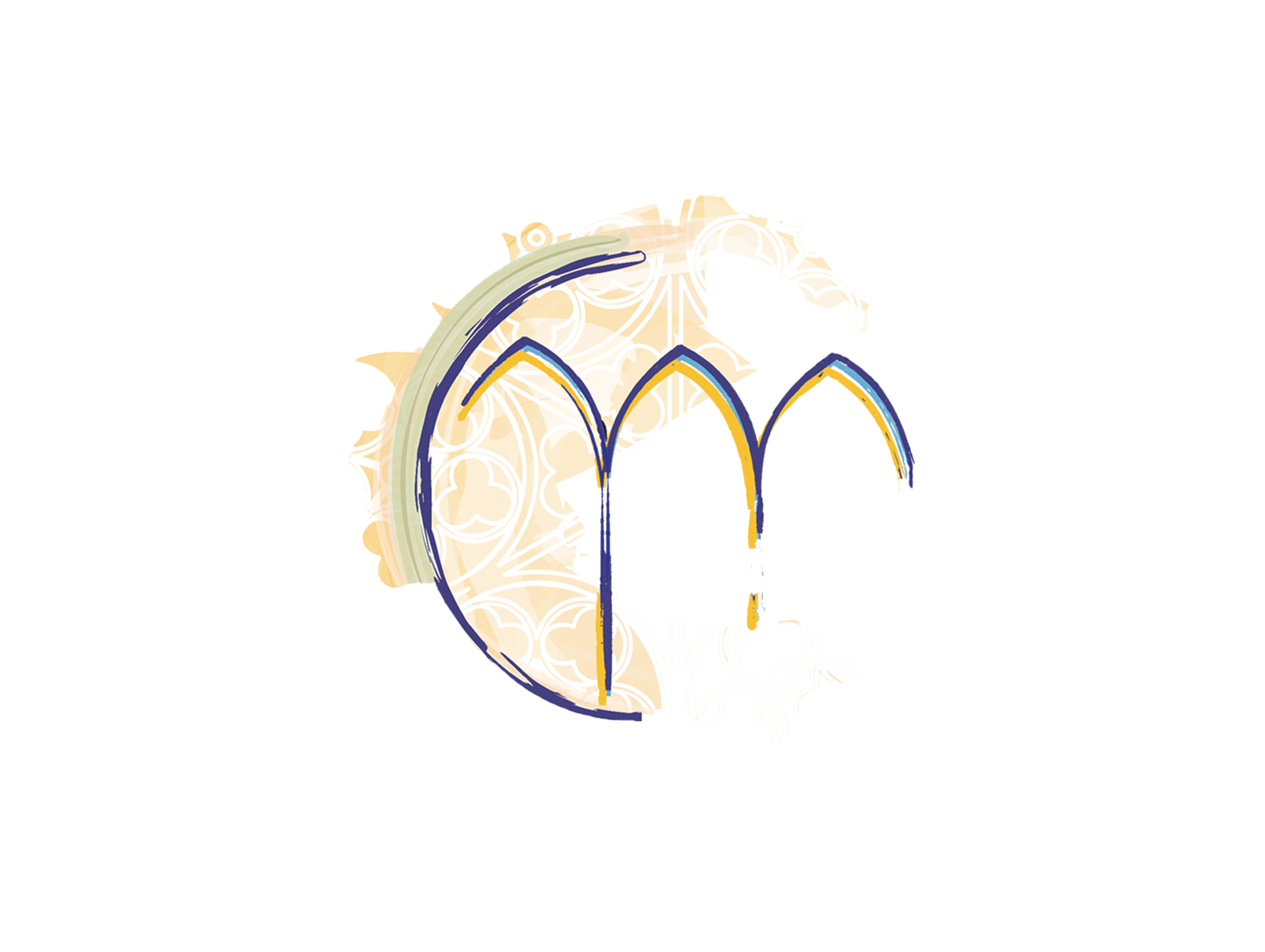L'église a été ouverte au culteen 1340
L'église se présente aujourd'hui dans sa forme gothique provençale d'origine, avec une façade à large cuspide, dans laquelle se trouve l'ancienne rosace ajourée, et un pronaos à arcs brisés
L'intérieur comporte une seule nef avec dix chapelles de chaque côté. Le presbytère est caractérisé par la présence de monuments funéraires de la famille royale angevine. Au centre se trouve le tombeau de Robert d'Anjou réalisé par les frères Bertini, tandis que les deux tombeaux du côté droit, destinés à accueillir les dépouilles de Charles de Calabre et de Marie de Valois, sont l'œuvre du grand maître Tino di Camaino. Le tombeau de gauche, en revanche, est celui de Maria di Durazzo, réalisé par un sculpteur anonyme, connu sous le nom de Maestro Durazzesco.
Outre les monuments funéraires angevins de Sainte-Claire, les restes de la famille Bourbon y sont également conservés.
En 1742, l'église a été modifiée par l'architecte Domenico Antonio Vaccaro. Un vaste revêtement a donné au complexe une apparence baroque.
Le 4 août 1943, l'église a été presque entièrement détruite par un raid aérien. Elle fut reconstruite et restaurée sous la direction de Mario Zampino dans le style gothique d'origine. Dix ans plus tard, le 4 août 1953, l'église a été rouverte au culte.
Derrière le maître-autel se trouve l'ancien chœur des Clarisses, une pièce d'où les moniales participaient aux offices religieux. La chapelle, structurée comme une salle capitulaire cistercienne, se compose de trois nefs, dont deux sont couvertes par des voûtes d'arêtes. Le chœur, aujourd'hui chapelle d'adoration, est un espace réservé à la prière,
Immédiatement après la chapelle de Bourbon se trouve le seul morceau de fresque qui ait survécu aux vicissitudes de l'église.
Elle représente la Vierge laborieuse ou couturière. Malgré un important défaut d'enduit dans la partie gauche de la fresque, on peut apercevoir, à hauteur de la tête de la Vierge, l'extrémité de ses doigts joints serrant une aiguille et tirant, avec agilité et dextérité de couturière, le fil avec lequel elle va raccommoder le tissu froissé sur l'une de ses jambes. L'Enfant, pensif, est assis de côté sur le sol, les jambes croisées et un doigt sur la bouche, référence à l'Eucharistie. Derrière lui, exactement dans l'axe du croisement de ses membres, se trouve une croix, référence évidente à la Passion.
La seule chapelle de la basilique à avoir conservé son habillage du XVIIIe siècle abrite actuellement les dépouilles de plusieurs princes de la Maison de Bourbon Deux-Siciles, et en particulier, à gauche, le monument funéraire du prince Philippe, mort en 1777, fils du roi Charles III, exécuté d'après un projet de Ferdinando Fuga par Giovanni Attigiati, tandis que les chérubins sont l'œuvre de Giuseppe Sammartino.
 1310La construction du complexe par le roi Robert d'Anjou et sa seconde épouse Sancia de Majorque
1310La construction du complexe par le roi Robert d'Anjou et sa seconde épouse Sancia de MajorqueLes travaux ont été réalisés sous la direction de Gagliardo Primario d'abord, et de Lionardo di Vito ensuite. En 1340, l'église fut ouverte au culte. La citadelle franciscaine a été bâtie en construisant deux couvents adjacents mais séparés : l'un pour les femmes, destiné à accueillir les Clarisses, et l'autre pour les hommes, destiné à accueillir les Frères mineurs franciscains.
- Vaccaro et la "modernisation1742

Le projet a été confié à l'architecte napolitain Domenico Antonio Vaccaro.
Des revêtements minutieux lui donnent un aspect baroque : l'intérieur est recouvert de marbres polychromes, de stucs et de corniches dorées ; le toit en treillis est dissimulé par une voûte décorée par les grands peintres de l'époque
 1943La guerre
1943La guerrePendant la Seconde Guerre mondiale, l'église a été presque entièrement détruite par un raid aérien.
- POST FATA RESURGO1953

Elle a été reconstruite et restaurée dans le style gothique d'origine et a été rouverte au culte exactement dix ans plus tard.
Aujourd'hui, elle présente une large façade cuspidée, sur laquelle se trouve l'ancienne rosace ajourée.